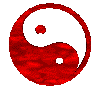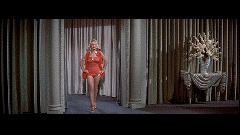-
HOPITAL SAINT LOUIS.. ( R. Sabouraud ( 1937 )
HISTOIRE DE L'HÔPITAL SAINT-LOUIS
Par R. Sabouraud (1937)
Ce petit ouvrage, édité en 1937 par les laboratoires Ciba, nous a été aimablement fourni par le Professeur Jacques Bardot, chirurgien plasticien à Marseille.
AVANT-PROPOS
Je voudrais brièvement résumer ici l'histoire de l'hôpital Saint-Louis, depuis sa fondation sous le règne de Henri IV, jusqu'à nos jours, rappeler les conditions qui ont déterminé sa naissance et les circonstances au milieu desquelles il fut élevé; dire ensuite les événements qui survinrent et comment cet hôpital fut utilisé, rappeler enfin les hasards qui ont modifié son rôle au cours des trois siècles que déjà, il a vécus, jusqu'au, XIXe où il devint le centre même de l'Ecole Dermatologique française, sa maison-mère et si l'on peut dire : son emblème représentatif.
En relatant succinctement cette histoire, j'éviterai les détails sans intérêt. Je n'ai pas la prétention de faire l'oeuvre complète d'un historien. En vingt auteurs qui en ont écrit avant moi, on trouvera la foule des menus faits auxquels je n'ai pas cru devoir m'arrêter.
Par contre il m'a semblé utile de rappeler au milieu de quelles conditions sociales, urbaines et hospitalières, la création de cet hôpital fut jugée nécessaire. Autant que nous pouvons nous reporter de trois cents ans en arrière, cette vue rétrospective nous aide à mesurer les difficultés qu'on eut à vaincre à cette époque et les efforts faits par les hommes pour y parer de leur mieux, même quand ces efforts ne nous semblent pas avoir donné tout le fruit qu'ils en attendaient, ou quand le fruit s'est montré différent de celui qu'ils en avaient d'abord espéré.
D'ABORD, en toute question qui, par un côté au moins, touche à l'histoire, il est présomptueux de formuler un jugement catégorique, parce qu'il est impossible à un homme d'aujourd'hui de se représenter les moeurs, les usages, les croyances, et même les nécessités d'une époque ancienne.
Il nous suffit maintenant d'appuyer sur un bouton pour faire naître de la lumière, est-ce que nous pouvons nous représenter nous-mêmes, battant le briquet dans la nuit pour enflammer une allumette de chanvre et allumer avec elle une chandelle de suif ou de cire?
Est-ce qu'un habitant de Paris actuel peut se représenter sa vie au XVe ou au XVIe siècle, lorsque l'alimentation de toute la ville dépendait entièrement de la batellerie venue de Melun, et que la moindre crue de la Seine faisait doubler le prix du pain. C'est une question pourtant qui remplit les chroniques du temps jadis et par exemple les Mémoires d'un bourgeois de Paris qui vivait sous Charles VII.
De même, comprenons qu'il est impossible au médecin de se représenter l'état sanitaire d'une grande ville de ce temps-là. Certes, on peut constater la fréquence des épidémies, il en est question presque à chaque page des chroniques anciennes, mais quant à deviner ce qu'elles ont été, de quelles maladies il s'agissait, cela est tout à fait impossible. On disait toujours la peste comme on disait plus tard le scorbut mais sans parler jamais de quelque symptôme que ce soit. Si c'est la peste, il n'est jamais question de la mortalité des rats qui la précède toujours, ni des bubons pesteux qui l'accompagnent presque invariablement sur chaque malade. On pourrait croire qu'il s'est agi en beaucoup de cas, du typhus exanthématique. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais question dans les vieux papiers, ni de la diarrhée du choléra, ni des croûtes de la variole, ni de l'angine de la diphtérie.
En racontant les méfaits d'une épidémie, les mémoires diront seulement que les pauvres gens mouraient par milliers, qu'on en trouvait morts « sur les fumiers dans les rues ». Et ce ne sont pas des hyperboles, les registres de l'Hôtel-Dieu comptent 68.000 morts pour la seule épidémie de « peste » de l'année 1562.
On comprend sans peine que les hôpitaux ordinaires de la ville ne pouvaient suffire en des cas pareils, mais ce qu'étaient les hôpitaux d'alors c'est ce qu'il nous est aussi très difficile d'imaginer. Et pour cela il est nécessaire de savoir comment ils étaient nés, comment ils avaient grandi.
Au Ve siècle de notre ère, les invasions barbares avaient laissé les populations survivantes dans un état de misère sans nom. Dès VIe vie et le VIIe siècles une foule de conciles provinciaux répètent aux évêques qu'ils sont responsables devant Dieu, au temporel comme au spirituel des pauvres gens de leur diocèse. Néanmoins l'organisation des hôpitaux fut lente à se faire. Nous ignorons presque toujours la date de leur fondation. C'est plus tard que nous trouvons des chartes royales ou seigneuriales, faites pour leur assurer des ressources et permettre leur fonctionnement. Ainsi la première charte de l'Hôtel-Dieu de Paris que nous connaissions est du Xe siècle. Cependant l'Hôtel-Dieu, alors bâti à droite du parvis Notre-Dame, avait à ce moment quelques trois cents ans d'existence puisque la tradition rapporte à saint Landry la création de son personnel hospitalier. Et ['Hôtel-Dieu avait succédé à un hôpital antérieur érigé sous le vocable de saint Christophe.
Façade méridionale de l'Hôpital Saint-Louis
A partir de sa fondation, Hôtel-Dieu représente pour le Paris d'alors, ce qu'est l'Administration de l'Assistance publique pour le Paris de nos jours. Toutes les fondations hospitalières naquirent de lui ou par son intermédiaire. Pendant des siècles il est resté le seul hôpital de Paris. A la vérité beaucoup de veuves et de vieilles gens mourant sans hoirs, faisaient héritiers les pauvres de leur paroisse, il y avait donc beaucoup de fondations pieuses, isolées, les unes faites par des particuliers, d'autres par des seigneurs, même par des rois, mais souvent dans un but spécial et limité, comme l'Hospice des Quinze-Vingts qui, à son origine avait abrité trois cents chevaliers revenus aveugles de la Croisade. Ces diverses fondations, sans lien commun, et sans direction commune, ne rendaient pas grand service à l'ensemble de la population. Et puis, surtout, la ville grandissait; il fallut bien songer à bâtir de nouvelles maisons hospitalières. On les conçut tout naturellement comme des filiales de l'Hôtel-Dieu.
La première fut créée dans le faubourg Saint-Marcel et sous le nom de saint Marcel. Durant très longtemps, cette maison put suffire aux besoins de la rive gauche et du quartier universitaire. Elle persista jusque sous Louis XIII, gardant son nom et son rôle. Ce fut Anne d'Autriche qui la supprima pour la remplacer par l'hospice Sainte-Anne, appelé ainsi de son nom, nom sous lequel il existe encore aujourd'hui. La seconde filiale de l'Hôtel-Dieu, fut l'hôpital Saint-Louis: mais sa construction ne fut décidée que dans les dernières années du XVIe siècle. Nous y reviendrons tout à l'heure.
La grande cour.
Il nous est presque impossible aujourd'hui de nous représenter le manque d'hygiène et de propreté des populations à cette époque, et dans toutes les classes de la société. D'abord la rareté de l'eau dans les villes rendait la propreté, difficile. Montaigne s'élevait encore contre les gens de son époque, vivant la peau «estoupée de crasse ». Les étuves d'origine gallo-romaine étaient devenues dès le haut moyen âge, des sortes de maisons publiques très décriées. La rue des Etuves-Saint-M.artin nous indique encore l'emplacement de l'une d'entre elles. En fait, il n'y avait de propreté que chez les filles galantes. Presque tout le premier christianisme et les ascètes avaient prêché la haine du corps, ne pouvant voir en lui que l'instrument du péché. Ainsi les femmes honnêtes en arrivaient à se faire gloire de leur malpropreté, comme faisant la preuve de leur vertu. Je voudrais bien être sûr qu'on ne trouverait pas en certains coins de nos provinces, quelques restes de ce préjugé.
Quant à ce qu'était un hôpital au Moyen Age, il est aussi très difficile pour nous de l'imaginer. Il y avait d'abord toute une population de pauvres diables qui en vivaient. Ensuite l'hôpital était toujours plein parce qu'il y avait un très grand nombre de maladies, bénignes en soi, mais qu'on ne savait pas guérir. La pouillerie et la gale étaient de ce nombre. On croyait encore que certains malades devenaient pouilleux spontanément et que leur peau engendrait les poux. On considérait donc comme impossible de les débarrasser de leur vermine, et on ne l'essayait pas. On comprend le nombre d'infestations qu'ils devaient semer autour d'eux. En fait, tous les malades hospitalisés devenaient pouilleux du fait de leur hospitalisation. Le pou étant le véhicule du typhus et le porteur intermédiaire de son germe, il est donc bien à croire que la soit-disant peste du Moyen Age était le plus souvent du typhus exanthématique.
Ce qui arrivait pour les poux arrivait de même pour la gale. C'est une maladie que l'on guérit aujourd'hui en vingt minutes, mais réfléchissons que sous le premier Empire on la traitait encore par des cures de petit lait pendant six mois et davantage, jusqu'à ce que les pommades soufrées eussent révélé leur vertu curatrice. Encore fut-il beaucoup discuté à ce moment pour savoir s'il n'était pas dangereux de guérir la gale aussi vite, sans prévenir par un traitement général les répercussions que la guérison pouvait avoir sur la santé générale. (Il y aurait un beau chapitre à écrire sur le rôle de l'imagination chez les médecins ! )
Dans toutes les grandes villes, il y avait deux catégories de pauvres : les vrais et, les faux ; ceux-ci se faisaient mendiants pour le profit et par paresse, et beaucoup arrivaient à se faire nourrir par les hôpitaux. A. diverses reprises on vit évacuer plus tard sur Saint-Louis les services de malades chroniques de l'Hôtel-Dieu, parmi lesquels des truands qui faisaient la loi.
Comment comprendre ce qu'était un hôpital comme l'Hôtel-Dieu ? Imaginez d'abord que toutes les fièvres éruptives sont. méIangées et méconnues, y compris les varioles. On distingue nettement les fièvres intermittentes des fièvres continues, celles-ci nommées putrides étaient surtout notre, fièvre typhoïde, et Dieu sait si, avec l'usage exclusif des puits, à proximité des puisards, l'eau d'alimentation devait être contaminée.
De tous temps les hôpitaux Comme l'Hôtel-Dieu avaient eu des consultations externes, souvent faites par un chanoine ou un médecin noir gradué, et qui comportaient d'habitude une distribution de pain. C'est par cette consultation sans doute que se recrutaient les malades hospitalisés à moins qu'ils ne fussent amenés d'urgence.
Ce qu'était l'hospitalisation à cette époque, parait à la nôtre un peu effarant. Jamais ou presque jamais un malade ne couchait seul ; il y avait trois ou quatre malades dans un même lit, quelquefois cinq., quelquefois plus, en temps d'épidémie. Cela paraissait alors tout naturel et, l'habitude nous dresse à ne nous étonner de rien. Ce fait qui nous parait quasi monstrueux s'est perpétué jusqu'à la veille de la Révolution. C'est le ministre Necker qui s'insurgea le premier contre cette coutume barbare et qui voulut qu'elle cessàt. Avec les lits communs à quatre et cinq malades, la police des salles était quasi impossible ; les batailles entre les malades d'un même lit. qui ne pouvaient pas se souffrir se terminaient par l'expulsion du plus faible ou du plus gênant qui s'en allait mourir par terre. C'étaient là des spectacles de tous les jours. Le personnel hospitalier était obligé à tout instant de faire intervenir les archers.
S'il en était ainsi en temps normal, quel spectacle pouvait présenter un hôpital en temps d'épidémie? A une époque où l'on savait si mal ce qu'il eût fallu faire contre elles, elles se reproduisaient presque chaque année.
Le développement de l'Hôtel-Dieu, resserré entre les bâtiments voisins ne pouvait se faire comme l'accroissement de la population l'aurait voulu. On sait que plus tard l'Hôtel-Dieu éleva, sur la rive gauche de la Seine, une annexe à laquelle un pont franchissant le petit bras de la Seine le réunissait. Mais avant que cette solution intervint, on se contentait d'élever les étages ou de multiplier les bâtiments aux dépens des espaces libres. On en avait élevé partout. Il fallut une catastrophe pour mettre fin à ces errements et ce fut l'incendie de l'Hôtel-Dieu en 1773.
De même pour décider de la construction de l'hôpital Saint-Louis, il avait fallu trois ou quatre épidémies de « peste » en dix ans. Vraiment, les évêques et les médecins recommandaient bien, en temps d'épidémie de ne pas mélanger les contagieux aux autres malades. Mais que faire contre une accumulation qui avait pour cause le manque de place et le manque de lits. Et puis, on discutait toujours sur les causes de la contagion. Même parmi les médecins, beaucoup croyaient à l'influence des constellations sur la naissance et le développement des épidémies. De telles imaginations rendaient illusoire la prophylaxie des maladies infectieuses, et empêchaient même de la croire possible. On implorait le ciel : « Quis contra Deum, sine Deus ipse ?» Alors on multipliait les processions...
Pourtant on avait bien su au XIIe et au XIIIe siècles prendre contre la lèpre et les lépreux les mesures de ségrégation et d'isolement qui convenaient, mesures draconiennes correspondant à la cruauté des temps, mais mesures utiles. A coup sûr on avait dû enfermer avec les lépreux beaucoup d'eczémas et de psoriasis qui n'avaient rien de commun avec la lèpre, mais on était parvenu à isoler et sequestrer tous les malades. L'histoire montre que cet isolement rigoureux atteignit son but.
Or, en ce qui concernait toutes autres maladies épidémiques, comme la peste ou ce qu'on appelait de ce nom, rien n'avait été prévu de semblable.
Lorsque au cours d'une épidémie, les malades nouveaux affluaient, on essayait d'abord de les parquer séparément, très vite on se trouvait forcé de les mélanger aux anciens, faute de place. Alors couchaient côte à côte contagieux et non contagieux. On conçoit l'extension que prenaient les épidémies et ce qu'était la mortalité parmi le personnel hospitalier. On pourrait presque dire qu'un hôpital ainsi compris n'avait qu'un but effectif, celui de capter les malades venus du dehors et d'en finir avec la maladie par leur mort.
La question se pose, et elle a été scientifiquement étudiée, de savoir comment une épidémie ainsi traitée pouvait s'éteindre et ne persistait pas indéfiniment. Les épidémies comme les maladies ont leur cause, leur loi de naissance et d'accroissement, de diminution et de mort. Les épidémies finissaient donc par s'éteindre mais sans qu'on ait su limiter leurs ravages. On ne contestait pas l'utilité de l'isolement s'il eût été réalisable, mais alors il ne l'était pas. Paris grandissait toujours, et il n'avait toujours qu'un hôpital d'autrefois, son Hôtel-Dieu déjà trop petit pour les besoins normaux de la population. Quand survenait une épidémie sévère, les moyens hospitaliers précaires en temps normal devenaient tout à fait insuffisants. L'évidence du fait devint si frappante qu'à la suite d'une série d'épidémies lamentable, on projeta d'établir une succursale de l'Hôtel-Dieu, destinée à ne servir qu'au temps des épidémies, et qu'on fermerait après elles. On pensa d'abord augmenter l'importance du Sanitat déjà existant au faubourg Saint-Marcel, mais cet établissement pouvait à la rigueur suffire pour la rive gauche. C'est surtout sur la rive droite de la Seine que Paris s'agrandissait et, de ce côté, il n'y avait aucun hôpital. On chercha donc un emplacement possible au nord de Paris et hors les murs. Le choix se porta sur des terrains de culture situés entre le vieux chemin de Pantin devenu de nos jours la rue de la Grange-aux-Belles, le faubourg du Temple et la rue Saint-Maur qu'on disait : le chemin Saint-Maur, autrefois. Ces terrains dépendaient de la paroisse Saint-Laurent, ils appartenaient pour une part à la maison de Saint-Lazare, pour une autre à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs. On possède encore les contrats passés pour l'achat du terrain et le nom des vendeurs. Et ceci se passait en 1607. Le 19 du mois de mai, le roi Henri IV, signait l'Edit qui fondait l'hôpital Saint-Louis, et dont on possède le texte dans son intégralité.
Sans doute, l'édit aurait-il tardé davantage si en la fin du XVIe siècle les épidémies ne s'étaient pas multipliées -- car de tous temps les pouvoirs publics ont reculé devant les décisions onéreuses -. Mais après la peste si cruelle en 1562, une autre était survenue en 1596 où l'impossibilité de tout isolement avait été démontrée. Enfin, en 1606 survint une épidémie nouvelle qui causa beaucoup d'effroi, ayant fait quelques victimes dans l'entourage de la cour.
Et c'est ainsi qu'avait été décidée la fondation d'un hôpital intermittent, spécialement destiné à soigner les pestiférés, ou comme on disait alors « les Empestez ». En souvenir du roi Saint Louis, mort de la peste devant Tunis en 1270, cet hôpital appelé d'abord Maison de la Santé devint l'hôpital Saint-Louis.
Premier plan de l'Hôpital Saint-Louis portant la signature de Maximilien de Béthune (Duc de Sully).
Certainement l'édit du roi avait été prévu d'avance car moins d'un mois après lui, trois plans étaient présentés au Roi qui choisit l'un d'eux. Ce plan exécuté sur parchemin est encore aux Archives de l'Assistance publique et porte le contre-seing, du grand voyer de France : Maximilien de Béthune, duc de Sully. Ce plan avait été établi par Claude Vellefaux « maître masson-juré, ès oeuvres de massonneries du Roy ».
Il est toujours surprenant de voir combien, à travers les âges et les révolutions, nos coutumes restent les mêmes, étant dictées par la nature des choses. Comme de nos jours, les travaux furent mis par voie d'affiche en adjudication. Le Bureau constitué par les gouverneurs de l'Hôtel-Dieu se réunit quatre fois, trouvant chaque fois les rabais proposés insuffisants. Et comme il arrive encore, il exigea de tels rabais que le premier entrepreneur allait s'y ruiner.
Au moins les choses furent-elles menées sans retard car les bâtiments principaux étaient déjà piquetés sur le terrain, lorsque deux mois après son édit, le roi Henri IV vint poser la première pierre de la chapelle. L'architecte, directeur et surveillant des travaux, et qui devait y paraître au moins une fois par jour, était Claude Vellefaux et l'entrepreneur Antoine le Mercier. Une armée de pauvres diables --- les chômeurs d'autrefois --- envoyée par Messieurs de la Police fut employée au transport des matériaux. On leur donnait leur nourriture et quelque argent. Les travaux furent rondement menés malgré la déconfiture du premier adjudicataire, et le gros oeuvre fut terminé en trois ans. Le premier office religieux célébré dans la chapelle, fut la messe mortuaire du roi Henri IV, assassiné par Ravaillac (1610).
Naturellement, les autorités religieuses stimulaient la curiosité et la piété des fidèles en accordant un pardon et des indulgences aux visiteurs de la chapelle qui apportaient leurs aumônes pour l'achèvement de la construction. La chapelle, alors située au bord même de la route de Pantin est une oeuvre simple, mais très caractéristique de l'époque. Sa façade charmante sur laquelle la forme même de la nef est dessinée, comporte deux statues dont nous avons encore le bordereau de commande portant mention du prix convenu : quatre-vingt-dix livres tournoys. S'il existe encore des cloches dans le petit campanile, ce ne sont plus, je le crains bien, celles qui furent commandées en juillet 1609 au maître-fondeur Le Moyne « bien sonnantes et accordantes l'une avec l'autre ».
Dans un hôpital, la chapelle était toujours le premier bâtiment construit, et souvent comme ici, à demi hors de l'hôpital, de façon à pouvoir servir de paroisse aux habitants du voisinage. La chapelle faisait donc saillie sur le chemin et le choeur seul était engagé dans l'enceinte de l'hôpital, de telle façon que la population civile et hospitalière y pussent chacune trouver leur place.
C'est au chevet de la chapelle que se trouvait l'entrée majeure de l'hôpital : un petit pavillon charmant qui abrite aujourd'hui le laboratoire Alibert. Au-dessus d'une porte aux jambages saillants, aujourd'hui murée, est le buste en bronze du Béarnais. Sous cette porte, partait le large escalier conduisant aux grandes salles de l'hôpital. Le plan de cet établissement immense est d'une remarquable simplicité, mais son ensemble est de proportions gigantesques. L'hôpital proprement dit forme un quadrilatère de 120 mètres de côté, limitant une grande cour intérieure et entourée d'un chemin de ronde large comme un boulevard. Ce quadrilatère présente en ses quatre angles, quatre énormes pavillons construits en brique et pierre, massifs et coiffés de toitures indépendantes. Ils sont reliés les uns aux autres par les quatre faces du quadrilatère, hauts murs blancs, de pierre, percés de longues fenêtres dont le sommet découpe le rebord des toits. Et chaque façade en son milieu présente une répétition des pavillons d'angle, un bâtiment de même dimension, construit en brique et pierre comme eux, dont le toit indépendant est couronné d'un clocheton ou campanile.
Au premier plan, à droite, l'Hôpital Saint-Louis.
L'ensemble est d'une simplicité de dessin, et d'une homogénéité parfaite. L'extérieur même des bâtiments démontre le but de leur construction, les longues fenêtres parallèles éclairant du haut en bas les salles d'hôpital, immenses et semblables à des nefs d'église; les grands pavillons à plusieurs étages signalant les services accessoires des salles et aussi leurs voies d'accès.
En dehors de cette masse quadrangulaire qui constitue dans l'hôpital la partie réservée aux malades, étaient construits quatre groupes de bâtiments bordant le chemin de ronde et symétriques deux à deux, ceux-ci destinés aux différentes catégories du personnel et aux services généraux.
En dehors de ces annexes étaient des terrains de culture limités par un mur d'enceinte muni de petits pavillons pour les jardiniers. Au fond de ce considérable domaine était un bâtiment isolé dit : le Pavillon royal. L'ensemble conçu et exécuté d'un seul jet, par un maître architecte, était d'une conception si belle, si claire, si parfaite et si homogène que la reproduction en devait tenter tous les artistes de cette époque. Beaucoup de graveurs se sont essayés à le reproduire et beaucoup d'épreuves nous sont parvenues de leurs essais. Elles montrent que dans son ensemble l'oeuvre d'autrefois est presque demeurée intacte et qu'elle a peu souffert en dépit de quelques destructions et appropriations regrettables. En considérant ces reproductions, on se rendra compte, mieux que par aucune description, de ce qu'étaient la conception de Claude Vellefaux et la réalisation qu'il en avait faite. L'ensemble donne une idée parfaite de la façon dont on comprenait alors ce que devait être un hôpital de contagieux.
Un angle intérieur de la grande cour.
Cependant, certaines particularités méritent pour des raisons diverses d'être soulignées. Il est curieux par exemple de remarquer, dans un établissement de cette importance, des malfaçons accusant une économie excessive dans la construction. D'abord ce monument immense fut construit, sans aucun sous-sol, sans aucune fondation profonde. Fut-ce vraiment par souci d'économie? Ou bien la nature du terrain put-elle faire craindre que des caves en sous-sol y fussent perpétuellement inondées? Je ne sais. Un ruisseau descendant de Ménilmontant côtoyait le nouvel hôpital pour aller se perdre vers la rue actuelle des Marais. En vérité, tout ce terrain alors consacré aux cultures maraîchères était fort marécageux. Lors de la fondation de l'hôpital, ce ruisseau pouvait infiltrer les terres de son voisinage et rendre aléatoire l'établissement de caves au-dessous des bâtiments. L'architecte usa donc d'un subterfuge. Tout l'étage construit au ras du sol sur trois mètres de hauteur fut considéré par lui comme un sous-sol à ciel ouvert et attribué à des celliers, à des resserres, à des magasins. Et ce rez-de-chaussée, voûté, forma le sous-sol aéré de l'hôpital. Ce ne fut que beaucoup plus tard, en 1798, je crois, que l'affluence des malades fit attribuer à des services hospitaliers tout ce rez-de-chaussée qui a l'origine n'avait pas du tout été fait pour eux.
C'est pour la même raison qu'à l'époque de la fondation de l'hôpital, trois grands escaliers extérieurs montaient directement au premier étage alors seul attribué aux malades. On supprima plus tard ces escaliers et c'est ainsi qu'en plusieurs des pavillons de façade, on n'accède plus au premier étage que par ce qui était autrefois des escaliers de service.
La grande entrée de l'hôpital était située, je l'ai dit, immédiatement derrière le chevet de la chapelle. En bas d'un pavillon carré de forme harmonieuse, une belle porte cintrée à claveaux saillants surmontée du buste du roi, conduisait au grand escalier d'honneur, démoli vers 1885, escalier couvert, continué par une longue galerie qui franchissait le chemin de ronde. C'est par ce passage que l'on accédait normalement aux salles de malades. La cage de cet escalier est devenue maintenant l'un des laboratoires de l'hôpital.
Les salles de malades, hautes comme des nefs, à poutres apparentes et dont le plafond est lambrissé en voûte, à huit mètres de hauteur, communiquaient toutes entre elles autour de l'immense quadrilatère de cent vingt mètres de côté. Depuis lors, elles ont été découpées de cloisons vitrées montant jusqu'aux voûtes et interrompant la continuité des salles, mais Tenon, dans son inspection de 1787, a décrit encore les salles communicant librement l'une avec l'autre. Le chauffage de salles pareilles était impossible avec les moyens de l'époque. On s'était contenté de construire par place d'énormes cheminées dont quelques-unes existent encore. Naturellement, aucun chauffage n'avait été prévu pour les magasins du rez-de-chaussée.
Une salle du rez-de-chaussée dans les anciens magasins de l'Hôpital. Dessin de René Fath (1886)
Dans l'ensemble, cet immense édifice construit sans fondations a peu bougé. Cependant, sur deux points, dans l'ancien pavillon du milieu de la façade ouest et dans le bâtiment attribué à la communauté, de graves tassements et des fissures se produisirent il y a quarante ans, obligeant à des travaux de fondation en sous-oeuvre, et même à des réfections partielles. C'est alors qu'on s'est aperçu des malfaçons singulières dans l'exécution des maçonneries. Extérieurement les quatre pavillons d'angle montrent une succession de pierres angulaires qui donnent l'impression d'une solidité absolue, mais lorsqu'on fut obligé à une reconstruction partielle, on s'aperçut que chaque pierre de taille avait été resciée en diagonale de façon à faire deux pierres avec une seule. En façade, elles semblent énormes, mais à leur extrémité, elles n'ont pas plus de deux doigts d'épaisseur. On se rappelle alors que le premier entrepreneur Le Mercier, ayant soumissionné l'entreprise à un prix trop bas, fut acculé à la faillite ; il faut croire que ses malfaçons n'avaient pas suffi à équilibrer les dépenses. Il fallut procéder à de nouvelles adjudications pour achever l'édifice.
En dépit des fautes de technique que l'on peut relever dans l'exécution, le monument, dans son ensemble a passablement résisté. A l'usage, il a subi beaucoup d'injures, mais beaucoup plus de la part des hommes que des siècles. Il garde encore aujourd'hui sa grande figure et sa majesté. L'immense quadrilatère avec ses murs aux longues fenêtres et ses massifs pavillons de brique, représente un ensemble géant, d'une harmonie et d'une unité saisissantes.
La cour intérieure aussi paraît immense. Tout autour d'elle, accotées aux murs, de petites tourelles carrées montées en briques, correspondent aux offices de chaque salle. D'autres sont des tours d'escaliers. L'ensemble est une joie pour l'oeil. Partout les hautes fenêtres empiètent sur les toits ce qui les découpe de la façon la plus élégante et la plus jolie. Dans l'ensemble, on remarquera l'emploi judicieusement combiné de la brique et de la pierre. En façade, tous les pavillons centraux et les pavillons d'angle, et sur la cour, les pavillons d'escalier et les pavillons d'office sont construits en briques, avec leurs angles et le tour de leurs fenêtres montés en pierre de taille, tandis que tous les murs plats sont de maçonnerie, laissant voir autour des fenêtres et entre elles des chaînes apparentes en pierre de taille. L'ensemble que le temps sans doute s'est chargé d'harmoniser est étonnamment heureux. L'énorme cour intérieure plantée d'arbres centenaires, de vieux acacias et de vieux ormeaux rappelle en plus grand les cours intérieures des béguinages, dans les Flandres.
Passage couvert réunissant à l'Hôpital les anciens bâtiments de la communauté.
Quand on songe aux immenses surfaces symétriques du bâtiment et à la monotonie qu'elles eussent pu engendrer pour l'oeil, on se rend compte de la variété que le mélange de la brique et de la pierre lui apporta. En outre, les multiples redans que font sur les surfaces murales planes, les pavillons d'office et les pavillons d'escalier, chacun couronné de son toit distinct; tout cela met dans l'ensemble une variété, extrêmement ingénieuse, sensible à l'oeil même d'un Barbare.
Paris contient très peu de monuments de cette époque et de ce style, et quand on a énuméré la place des Vosges, la façade sur la rue Vivienne de la Bibliothèque nationale, l'ancienne bibliothèque de l'Arsenal et l'actuel Collège Massillon sur le quai Henri-IV à l'angle de la rue du Petit-Musc, on a énuméré presque tous les édifices de ce style que Paris contient. Ensuite il faut aller au Palais actuel de l'Institut dont les admirables pavillons rappellent certes, par leurs proportions ceux de l'hôpital Saint-Louis. Mais ils en diffèrent par la nature des matériaux employés et le type de leur décoration.
En somme, chaque époque a laissé dans Paris quelque monument caractéristique, et c'est ce qui fait de la "grand'ville" un amoncellement de chefs-d'oeuvre. Mais il y eut des époques fécondes et d'autres dont les oeuvres sont rares. Telle fut la fin du XVIe et le premier début du XVIIe siècles. C'est pour cela que l'hôpital Saint-Louis, en dehors de sa valeur propre, architecturale, fixe tout spécialement l'attention. Vraiment, très peu de monuments dans Paris peuvent lui être comparés.
A l'esprit de celui qui parcourt cet hôpital pour la première fois, c'est une surprise de considérer l'extrême largeur du chemin circulaire qui fait le tour des bâtiments hospitaliers. Cette surface, occupée maintenant par des plantations et des plates-bandes, a près de quarante mètres de large. Cet espace libre dégage supérieurement la masse de l'édifice et lui assure toute sa grandeur. Mais ce large chemin circulaire avait son utilité. C'était un chemin de ronde gardé de jour et de nuit, soit par des hommes armés, soit par des chiens, pour éviter l'évasion des
contagieux.
N'oublions pas qu'à son début et pendant un siècle, l'hôpital Saint-Louis fut un hôpital temporaire très ordinairement vide, occupé seulement pendant la durée des épidémies. Alors il devenait presque une prison. Lorsque survenait une épidémie, l'Hôtel-Dieu constituait une véritable mission, une caravane, comprenant les chapelains, le personnel hospitalier et les soeurs de Saint-Landry, les médecins, les apothicaires et tous les services accessoires d'un hôpital : cuisine, buanderie, literie, magasins. Tout ce personnel devait être enfermé dans l'hôpital Saint-Louis jusqu'à la fin de l'épidémie et rester pendant tout ce temps sans communication d'aucune espèce avec l'extérieur. Et même, le personnel général ne communiquait avec le personnel proprement hospitalier que par des tours qui évitaient tous les contacts directs.
Entrée ancienne de l'Hôpital. Ce pavillon était la cage de l'escalier conduisant aux salles de malades.
C'est au delà de ce très large chemin de ronde que tous les pavillons des services annexes de l'hôpital étaient distribués d'ailleurs avec un remarquable souci de leur élégance particulière, de leur symétrie ou de leur asymétrie voulue, et un égal souci de leur valeur décorative dans l'ensemble.
Imaginez autour du quadrilatère central et massif constituant l'hôpital proprement dit, un second quadrilatère beaucoup plus grand et séparé du premier par le chemin de ronde. Supposez que de ce quadrilatère immense on ait conservé seulement les quatre angles en équerre et par-ci, par-là, des pavillons de porterie, vous aurez l'ensemble des services annexes de l'hôpital. C'était d'abord et d'une part le bâtiment de la Communauté, de l'autre celui des Médecins, chacun d'eux réuni au pavillon d'angle correspondant par une galerie couverte à un étage qui enjambait le chemin de ronde et dont celle qui demeure en partie intacte est de proportions charmantes. Aujourd'hui que la grande entrée de l'hôpital est reportée du côté sud, on se rend mal compte de la symétrie primitive de ces deux annexes. On ne la retrouve que si on se place à l'entrée ancienne de l'hôpital derrière la chapelle.
Ces bâtiments disposés chacun en équerre sont parmi les joyaux de l'hôpital. Le pavillon Lugol, situé au nord-ouest est un bijou, avec ses fenêtres dont les combles empiètent sur les toits, avec ses portes de forme et de proportions harmonieuses, avec le pavillon extérieur dans lequel est inclus l'escalier et les jolies lucarnes aérant et éclairant le dessous des toits. A ce pavillon demeuré intact, fait face au sud-ouest, le bâtiment d'administration, beaucoup moins respecté par elle, et dont les charmantes lucarnes ont été remplacées par des vasistas anachroniques.
Hélas! le pauvre hôpital eut à subir de plus gros outrages. Autrefois, un établissement de cette importance était supposé, comme un château seigneurial pouvoir vivre sur lui-même. Il était donc le centre d'un domaine où se cultivaient les arbres fruitiers et les légumes du potager. On avait même établi un jardin botanique pour approvisionner de simples, l'apothicairerie, et c'est sur ce domaine alors libre de toute construction sauf quelques menus pavillons de jardiniers, et clos de hauts murs, que l'Assistance publique a construit depuis quarante ans une multitude de bâtiments parasites qui ont à peine respecté l'ordonnance ancienne de l'oeuvre de Claude Vellefaux. Ce furent d'abord des bains, et puis des bâtiments pour le personnel, d'autres pour des services nouveaux, pour une Maternité, qui vient toucher le délicieux pavillon Lugol. On comprend que de nouveaux besoins ou de nouveaux usages obligent à des créations nouvelles, mais peut-être serait-on en droit de demander aux architectes de l'Administration et aux Commissions qui les jugent un peu plus de respect du passé et de compréhension des chefs-d'oeuvre qu'ils massacrent. Cependant, ici et là, deux petits pavillons de jardinier existent encore, et aussi le haut Pavillon royal ou Pavillon Gabrielle, qui marquait le fond du domaine et dont une tradition encore vivace, apparemment fausse, attribuait l'origine aux écuries de la Belle Gabrielle.
Façade méridionale de l'Hôpital vers 1830 (Musée Saint-Louis)
L'ouest du domaine, région centrée par la chapelle, est celle qui a le plus souffert des constructions surajoutées, soit que les architectes modernes aient distribué comme au hasard leurs bâtiments nouveaux, soit qu'ils aient prétendu, comme a l'Ecole Lailler [1], rappeler avec leurs constructions l'architecture ancienne du vieil hôpital. Dans ce cas en effet, le contraste est pire.
Le manque de proportions et d'homogénéité devient, criant, et aussi le manque de génie des successeurs de Claude Vellefaux. Mais à quoi bon récriminer ; tant qu'il dure, un monument doit s'accommoder à l'usage qu'on en fait. Tout ce qui vit se modifie incessamment et les monuments comme le reste. Par contre, un fait bien caractéristique de l'époque où l'hôpital fut construit, c'est que les architectes qui avaient bien pensé à la lumière, à l'aération, ne s'étaient aucunement préoccupés de l'adduction d'eau potable, ni de la question des égouts. Et l'on supposait à l'hôpital une population de onze cents malades! Il est vraisemblable que les jardins de l'hôpital, comme ceux de Versailles sous le grand Roi, devaient servir de champ d'épandage. A grand'peine avait-on rempli, sans doute avec l'eau des toits, quelques bassins pour les lavandières et le service de la buanderie; quant aux eaux polluées, elles s'en allaient vers un puisard, bientôt rempli et nauséabond,
Plus tard on ira chercher au loin une source qui était propriété royale pour l'amener sur place, mais l'eau en était séléniteuse, et le plus simple pour l'Administration sera enfin de faire marché avec des porteurs d'eau pour amener chaque jour "deux muyds d'eau de Seine" à l'hôpital. (Deux muyds faisaient six barrriques de 250 litres, soit 1500 litres).
On voit aussi à maintes reprises l'Administration faire requête aux autorités pour qu'elles assainissent la région. A cette époque c'était la zone, et une zone assez décriée, car l'ancien gibet de Montfaucon était proche. Le vieux chemin de Pantin devenu aujourd'hui la rue de la Grange-aux-Belles y conduisait. On le trouvait sur la gauche quelques cent pas plus loin, vers la place actuelle du Combat, je pense. Au pied- du gibet, les voisins venaient amonceler leurs détritus et leurs gadoues, et comme les usagers de l'hôpital devaient faire de même on conçoit les récriminations du personnel et des malades. Quoi qu'il en soit, à cette époque jamais ne serait venu à l'idée d'un architecte, qu'avant même de construire un bâtiment il devait s'inquiéter de l'apport d'une eau propre et de l'élimination des eaux usées.
Vue de la cour intérieure vers 1830
L'hôpital Saint-Louis y compris les combles et les annexes fut terminé en 1612. Mais les salles ne furent ouvertes aux malades qu'en 1616, et c'est deux ans plus tard qu'une épidémie de « peste » se déclara. Pendant vingt ans l'hôpital resta ouvert, avec des contagieux en permanence. Epidémie de peste, dit-on toujours, peut-être épidémies diverses et dont certaines furent violentes car dix-sept religieuses furent contaminées. Toutefois, à la fin de l'année 1636, l'épidémie fut éteinte et l'hôpital évacué.
Il fut rouvert en 1651, pendant la Fronde. On se battait sous les murs de Paris; l'hôpital Saint-Louis reçut des blessés de la bataille du faubourg Saint-Antoine. Ensuite l'hôpital est de nouveau fermé et on ne parle plus de lui.
En 1670, nouvelle et grave épidémie. Cette fois elle est baptisée « scorbut », elle dura peu, et six mois après, de nouveau l'hôpital ferma ses portes. Chose étrange, depuis lors, il ne fut plus jamais question de peste ou de ce qu'on avait appelé ainsi, mais toujours de scorbut, et ce scorbut pourrait avoir été de la diphtérie (1693).
A cette époque une grande disette augmenta la misère et la mendicité et, pour un an, l'hôpital Saint-Louis servit de dépôt de mendiants et de vagabonds. En 1709, nouvelle épidémie de scorbut. On place 800 malades à l'hôpital Saint-Louis qui ne ferme ses portes qu'en 1710. Et la même histoire se répète en 1729.
Cependant, l'hôpital Saint-Louis très souvent inoccupé, tentait parfois les pouvoirs publics en quête de locaux pour divers besoins de la ville ou de l'Etat. Déjà en 1719, le Régent voulut y transférer les ateliers de la Monnaie, mais les représentations du Conseil d'Administration de l'Hôtel-Dieu firent avorter ce projet. En 1731 et 1740, le lieutenant général de police, d'ordre du Roi, convertit l'hôpital en magasin ou plutôt en entrepôt de blé.
En outre, pour la seconde fois en 1749 on y enferme pendant l'hiver, les mendiants valides et vagabonds qui infestaient Paris. Notez qu'une statistique de l'époque porte à 40.000 le nombre des mendiants de Paris.
Cependant en 1658, Louis XIV avait institué, en marge de l'Hôtel-Dieu et de ses filiales : l'Hôpital général qui renfermait les pauvres et les faisait travailler. L'hôpital général avait son centre à la Pitié et comprenait la Salpêtrière, l'hospice de Bicêtre, les Enfants trouvés, l'hospice du Saint-Esprit et de Vaugirard, etc... Avec l'institution de l'Hôpital général, la décentralisation hospitalière commençait.
En 1754, on ouvre de nouveau l'hôpital Saint-Louis pour dégorger l'Hôtel-Dieu encombré de plus de 1.200 scorbutiques. L'occupation de l'hôpital Saint-Louis se, prolongea. Il reçut 4.000 malades. On ne le ferma qu'en 1767.
Enfin, en 1773 l'Hôtel-Dieu brûla. On transporta en hâte à l'hôpital Saint-Louis, les malades retirés de l'Hôtel-Dieu. Désormais l'hôpital Saint-Louis ne sera plus fermé. On discuta longtemps pour savoir si l'Hôtel-Dieu serait reconstruit. Necker-voulait avec grande raison disséminer partout dans Paris des hôpitaux où il y eut un lit pour chaque malade et qui seraient indépendants. On projetait de grandes réformes. Le baron de Breteuil annonçait la volonté du Roi de démolir l'hôpital Saint-Louis et l'hospice Sainte-Anne pour les reconstruire et, comme on dit aujourd'hui, les moderniser.
.Mais les événements se précipitèrent. En 1791, l'Administration générale des Hôpitaux et Hospices avait remplacé les gouverneurs de l'Hôtel-Dieu et nous entrons à cette date dans l'ère moderne.
Il était évidemment dans les destinées de l'hôpital Saint-Louis qui n'avait été à l'origine qu'un hôpital temporaire de devenir un hôpital permanent. D'abord il n'y a que le provisoire qui dure, dit l'opinion, mais c'est parce que le provisoire est le premier moyen qu'on trouve pour obvier à une nécessité permanente. Voilà comment le fait se produisit. L'Hôtel-Dieu était perpétuellement encombré par une série indéfinie de maladies chroniques. On pensa que par sa situation au centre de la ville, l'Hôtel-Dieu devait bien mieux correspondre au service des maladies aiguës, et que tous ses malades chroniques devaient être évacués sur l'hôpital Saint-Louis.
Le baron Alibert
On réunit donc tout un lot d'incurables et de malades chroniques : des cancéreux, des scrofuleux (écrouelles et lupus), des malades atteints de teignes, de gales, de fistules et d'ulcères chroniques ; et ils furent transférés à l'hôpital Saint-Louis. On pensait que ces maladies de longue durée ne nécessiteraient pas la visite quotidienne des médecins, alors que cette visite dans un quartier aussi excentrique était difficile à exiger d'eux ( !). Désormais, à la vérité, le quartier de l'hôpital Saint-Louis faisait corps avec la ville; il n'était plus dans sa banlieue, mais il restait excentrique et d'un accès assez difficile. Il est vraisemblable que lorsqu'on décida de remplir l'hôpital Saint-Louis avec ces déchets des autres services hospitaliers, on ne croyait pas faire oeuvre durable. Elle dure pourtant depuis cent cinquante ans. Un arrêté du Conseil d'Administration des Hospices en date du 27 novembre 1801, sanctionne et consacre la spécialisation de l'hôpital Saint-Louis, et son premier médecin Alibert nommé en 1803 ouvrit la série des grands dermatologistes du XIXe siècle.
L'OPINION publique toujours simpliste voudrait volontiers que la science des maladies cutanées fût née à l'hôpital Saint-Louis et de l'hôpital Saint-Louis. Mais c'est là une erreur grande. De tous temps il y avait eu des dermatologistes en France et des ouvrages médicaux français consacrés â la Dermatologie.
Les premiers vinrent de notre Ecole de Montpellier, elle-même la première en date de nos Facultés. Elle était née entre le XIe et le XIIe siècle, fille de l'Ecole de Salerne d'une part, et d'autre part, de la très vieille école arabe de Cordoue. Elle avait donné des hommes éminents tels que Laurens Joubert, Arnauld de Villeneuve et bien d'autres. Notre Faculté de Paris avait eu les siens. Les Astruc, les Lorry. Celui-ci, Ch. Lorry demande une mention spéciale, lui, dont le livre magistral De morbis cutaneis est une mine d'observations précises, écrites en un amusant latin cicéronien. Lorry vivait sous Louis XV, il est d'ailleurs l'arrière grand-père d'un de nos meilleurs médecins d'enfants, car il y a des familles médicales, même parisiennes, pluricentenaires. Alibert; était donc très loin d'être le premier médecin français qui se soit consacré à l'étude des affections cutanées, mais il eut d'emblée la claire vision de ce qu'un hôpital comme l'hôpital Saint-Louis allait pouvoir représenter comme centre d'études et d'enseignement. Il se consacra tout entier à cette idée de créer là une Ecole française de Dermatologie, si convaincu d'avance de son éclat à venir qu'il eût voulu inscrire sur sa porte la devise romaine : Urbi et orbi.
C'était un observateur précis, attentif, méticuleux. Tous les types morbides qu'il a décrits le premier nous sont restés avec le nom même qu'il leur imposa. Toutes ses descriptions sont restées classiques. Son enseignement plein d'humour et d'esprit réunissait autour de lui une foule d'élèves. En été il faisait ses cours de clinique en plein air, dans le jardin du Pavillon Gabrielle. Ainsi faisait Platon dans le jardin d'Academos. Ce n'était pas d'ailleurs que les idées générales d'Alibert sur la Dermatologie fussent ni très neuves, ni très personnelles. En fait, il continuait les vieux enseignements de l'Ecole de Montpellier; il parlait presque comme Laurens Joubert. Il suivait encore la vieille nomenclature de tradition arabe, dont l'origine était galénique, Alibert la suivait même de fort près. Ses théories se trouvaient très vieilles, presque périmées à l'époque même où il les professait, lui le dernier d'une longue lignée. Il n'est donc pas étonnant de voir même ses propres élèves abandonner ses classifications vétustes, pour celles plus modernes de Plenck, un Viennois, reprises et remaniées par deux Anglais - Willan et Bateman.
Mais si les idées dermatologiques d'Alibert ne lui survécurent pas toutes, l'exemple de sa vie et de son enseignement fut fertile et son désir de créer à l'hôpital Saint-Louis un enseignement spécial et d'en faire une grande école dermatologique, ce désir, le XIXe siècle le réalisa, sans doute plus amplement qu'Alibert ne l'aurait jamais pu supposer.
La première génération des dermatologistes français, après Alibert, comprit Gibert, Devergie, Biett et Lugol. Gibert qui individualisa le Pityriasis rosé et inventa le sirop de Biodure d'hydrargyre ioduré, cent fois copié depuis lors par une série de médicaments spécialisés qui ne seraient pas nés sans lui. Devergie, qui soutint le premier l'idée des dermatoses mixtes et composées. Lugol qui introduisit l'iode dans le traitement de la scrofule, ainsi qu'on appelait alors les tuberculoses externes. Biett avait fourni la première description clinique de la Séborrhée sous le nom d'Acné sébacée et il avait introduit en France les nouvelles classifications willaniques en face des anciennes classifications d'Alibert. Ces classifications gardèrent leur valeur pendant soixante ans et il en persiste quelque chose dans celles dont nous usons encore aujourd'hui.
Le Docteur Biett, d'après un dessin (Musée Saint-Louis)
La suivante génération fut celle de Cazenave, de Bazin et de Hardy. Nos théories médicales comme nos théories politiques changent d'âge en âge. Biett, après Willan Bateman, attachait la plus grande importance à la forme des lésions cutanées pour les classer ; Bazin au contraire, au vice humoral profond et caché qu'il supposait au-dessous d'elles. Comme toujours les deux opinions antagonistes ont chacune leur raison d'être, et le sage, en s'aidant des lumières du moment, sait faire son chemin entre l'une et l'autre, mais le grand public médical, comme le suffrage universel aime les meneurs intransigeants qui glorifient leur opinion sans mesure, en vitupérant l'opinion adverse. Ainsi Bazin connut-il d'immenses succès de parole et de doctrine, sans ajouter sensiblement, à nos connaissances en dermatologie, car s'il a fait entrer dans la Pathologie les affections cutanées dues à des parasites cryptogamiques, ce n'est pas lui, c'est David Grüby qui les avait découvertes.
A cette époque, à l'hôpital Saint-Louis, les services dermatologiques, gouvernés par des maîtres différents ont été souvent eu lutte, sinon en guerre ouverte. Les oeuvres de Devergie, Cazenave, Bazin ne les montrent pas tendres l'un pour l'autre et les élèves épousaient les querelles de leur Maitre. Mais c'est alors qu'un enseignement est vivant, c'est quand les Maîtres s'accusent réciproquement d'hérésie. Ainsi en était-il en tous les temps de fortes croyances, et à Athènes, lorsque les philosophes soutenaient chacun leur doctrine.
Bazin, qui avait pris pour type dermatologique la Syphilis, découpée en période primaire, secondaire et tertiaire, avait conçu toute la dermatologie sur le même plan. D'abord il l'avait partagée toute entre cinq diathèses, et chacune d'elles comparable à la Syphilis. C'était particulièrement la scrofule, l'herpétisme et l'arthritisme. La scrofule est devenue la tuberculose externe, et pour elle on peut encore à la rigueur parler de périodes, mais que sont les périodes primaires et secondaires de l'herpétisine et de l'arthritisne,, et que désignent ces mots vagues, sinon des conceptions idéales très peu commodes à formuler avec précision. Cependant, si l'herpétisme survécut peu à son auteur, l'arthritisme eut, avec Bouchard, une longue période de survie. On se sert encore de ce mot sans bien s'entendre, d'ailleurs sur ce qu'il veut dire.
Le Docteur Bazin (Musée Saint-Louis)
Je n'ai connu cette époque de Bazin que par ses livres, et il est bien intéressant aujourd'hui de les relire et de voir en chaque auteur le mélange des erreurs et des vérités qu'il a soutenues avec le même feu. C'est une lecture propre à éteindre chez nous toute vanité, car nos successeurs penseront de même de ce que nous avons écrit et enseigné. Ni Bazin, ni son adversaire Cazenave n'avaient tout à fait raison. Bazin venait d'introduire dans la Dermatologie cette idée fausse de la contagion de la Pelade, erreur qui nous a poursuivis pendant cinquante ans, et pendant ce temps Cazenave refusait d'admettre la réalité des champignons parasites, démontrés par Grüby dans les teignes. Pour lui, ce n'était que des illusions du microscope.
Mais quelle superbe, et quelle certitude dans l'enseignement dogmatique de Bazin, même quand il soutient des absurdités. Et quelle finesse mordante, et quelles pointes acerbes dans l'enseignement contraire de Cazenave. Même quand il s'agit de jeux démodés, il fait beau regarder de grands champions et de beaux jouteurs.
A cette période homérique a succédé celle que j'ai connue, où les grands Maîtres de l'hôpital Saint-Louis étaient Vidal, Besnier et Fournier, et à côté d'eux des maîtres comme du Castel et comme Tenneson qui n'ont pas laissé une oeuvre notoire, mais qui faisaient pourtant d'excellents élèves.
Besnier, qui fut mon maître, était un orateur incomparable et un écrivain médiocre. Son oeuvre parlée a laissé dans l'esprit de ses élèves un souvenir définitif, son oeuvre écrite déçoit un peu ses lecteurs. Il fut pendant vingt ans le Maître incontesté de la Dermatologie française et un homme qui en étendit l'éclat bien au delà de nos frontières. Il fut le président type de la Société française de Dermatologie, le père et le fondateur de nos congrès internationaux.
Pendant ce temps, Alfred Fournier, nommé le premier: Professeur de Syphiligraphie de la Faculté se consacra exclusivement à cette science. Il en étendit prodigieusement le domaine, en prouvant l'origine syphilitique de la Paralysie générale et de l'Ataxie locomotrice. C'était montrer une face nouvelle de problèmes étudiés jusque-là hors de l'hôpital Saint-Louis, avec Ricord à l'hôpital du Midi, avec Rollet de Lyon, à l'Antiquaille.
On peut dire qu'à partir de ce moment la renommée de l'hôpital Saint-Louis devint européenne et mondiale. L'enseignement de ces Maîtres a peuplé le monde d'élèves qui ont disséminé leur doctrine en tous pays. Et cet enseignement était formulé dans une langue claire et simple, avec la mesure dans la forme qui avait été jadis le grand mérite des maîtres grecs dont nous passions alors pour être les seuls héritiers.
Le Professeur Fournier (Musée Saint-Louis)
Le nom même de l'hôpital Saint-Louis devint un symbole, quelque chose comme un totem. Avec son nom, c'est toute la dermatologie française du XIXe siècle que l'on évoquait.
Je m'en voudrais de raconter même aussi brièvement l'histoire de l'hôpital Saint-Louis sans mentionner le nom du docteur Lailler, un médecin de Saint-Louis qui fut un grand homme de bien. Après la Commune de Paris en 1871, lors de la rentrée dans Paris des troupes régulières, l'hôpital Saint-Louis regorgeait de blessés du parti vaincu. Lailler alors en fit fermer les portes et se tint derrière elles pour répondre à toutes réquisitions des autorités. Le vieux médecin avait accroché à sa vareuse d'hôpital sa croix de la Légion d'honneur.
Plusieurs officiers de l'armée régulière se présentèrent pour perquisitionner dans l'hôpital, il les convainquit assez facilement de n'en rien faire, et ils passèrent. Un dernier survint, plus arrogant, qui voulut bousculer le vieux médecin et passer outre. Alors celui-ci arracha sa croix de la Légion d'honneur et la lui jeta au visage. (Il n'en porta plus jamais l'insigne). L'officier dernier venu, frappé d'étonnement devant ce geste du médecin, se retira lui aussi. Ainsi furent sauvés les blessés qui remplissaient les salles de chirurgie.
Lailler était un vieux huguenot particulièrement docile aux suggestions de sa conscience. C'est lui qui suggéra à l'Assistance publique, l'idée de créer à l'hôpital Saint-Louis une école, (Elle porte aujourd'hui son nom) où l'on traiterait les enfants teigneux, évincés des écoles publiques pour cause de contagion, et qui devenaient de petits vauriens. Enfin, c'est lui encore, qui, ayant rencontré un mouleur italien, capable d'imiter à s'y méprendre les fruits en pâtes colorés, le fit installer à l'hôpital Saint-Louis pour y reproduire par des moulages les principaux types des diverses affections cutanées. Ce musée Baretta, ainsi appelé du nom du mouleur qui l'a fait, comprend des milliers de figures d'une perfection sans égale. Ce fut là une innovation qui fut imitée plus tard en tous pays. Mais tous les musées semblables, en Europe et en Amérique sont nés du nôtre, et leurs premières pièces, faites de la main même de Baretta. Assurément une telle collection n'a rien de commun avec les salles de sculpture du musée du Louvre. Aux veux d'un profane ce serait même un Musée des Horreurs, fait pour le médecin d'un drame du Grand Guignol. Mais il ne s'agit pas d'oeuvres de Beauté, il s'agit de vérité scientifique et d'enseignement. De ce point de vue un tel musée est d'une utilité sans pareille.
Le même bâtiment, dont la laideur hélas!, est bien moderne, abrite à côté du musée, la bibliothèque de l'hôpital, bibliothèque qui est la plus riche du monde en oeuvres dermatologiques. Beaucoup de médecins sont bibliophiles. L'usage s'est généralisé, parmi les Maîtres de l'hôpital, de léguer a cette bibliothèque, tous leurs livres. Ainsi s'est trouvé constitué le fonds le plus considérable d'ouvrages dermatologiques de toutes époques et de tous pays, et contenant les livres anciens en des éditions rarissimes, trésor de collectionneurs.
Récemment s'est adjoint à cet ensemble un musée histopathologique ayant à sa tête l'homme le plus représentatif de cette branche de notre science, et qui collationne une série de préparations microscopiques telles que les pareilles n'existent nulle part.
Buste du Docteur Brocq, par le Docteur Sabouraud (Musée Saint-Louis)
Avec la disparition des maîtres de la génération que j'ai connue la première à l'hôpital Saint-Louis, il ne faudrait pas croire que l'Ecole française de Dermatologie soit morte. Une série d'autres Maîtres a succédé à celle-là. Je ne puis nommer d'elle que les morts, mais les seuls noms de Louis Brocq, de Jeanselme et de Beurmann montrent combien, à l'époque suivante, notre Ecole fut loin de péricliter. Et je puis ajouter que la valeur de ceux qui sont encore vivants, si elle n'efface pas celle des morts anciens, permet de croire qu'il y aura de beaux jours encore pour les travaux à venir du vieil hôpital Saint-Louis.
Cependant, ce vieil hôpital a beaucoup changé depuis quarante ans, et voici comment. Autrefois, au moyen age on voulait qu'un hôpital se suffit à lui-même et qu'il eût autour de lui des terres de quoi nourrir sa population.
Aujourd'hui, l'Administration de l'Assistance publique veut qu'en chaque hôpital, chaque branche de la médecine ait un service qui la représente. Autrefois l'hôpital Saint-Louis n'avait même pas un service de médecine générale. Maintenant il contient en outre de six services de maladies cutanées et syphilitiques, trois services de chirurgie et un service de médecine générale, en outre une Maternité. On y a créé encore : un service d'oto-rhino-laryngologie, un service d'ophtalmologie, un service complet d'urologie, un service de dermatologie infantile, un autre de médecine et un autre de chirurgie d'enfants. En outre, il existe dans l'hôpital un service important de radiologie et de photothérapie, un pavillon spécial est réservé aux lépreux. Enfin il existe encore l'Ecole Lailler, où l'on traite les enfants teigneux.
Pour donner une idée claire de ce qu'est devenu cet hôpital, on me permettra d'énoncer seulement trois chiffres qui en témoignent. En 1936, tous les services de l'hôpital Saint-Louis ont hospitalisé 27 884 malades et donné 777.591 consultations externes. Je ne veux pas insister sur le détail des services rendus par un pareil établissement, et je dirai seulement que son budget actuel est de l'ordre de vingt-cinq millions.
Peut être le vieil architecte de l'hôpital, Claude Vellefaux, s'il pouvait voir ce qu'est devenu son oeuvre, après trois cents ans de durée et de bons services, regretterait-il la sobre et sévère ordonnance de son plan primitif qu'il trouverait sans doute un peu saccagé. Mais il pourrait aussi considérer les améliorations que le temps introduisit dans son-oeuvre, spécialement en ce qui touche au confort des malades, à leur hygiène, à l'apport des eaux neuves, froide et chaude, aux égouts au chauffage, et admirer qu'on ait pu introduire de telles améliorations dans son vieil édifice sans le détruire.
Entrée de la Chapelle
Mais peut-être au fond de lui, et tout en appréciant les inventions et les innovations modernes garderait-il pour les constructeurs de notre temps un secret mépris, de ce fait : que les hommes sachant maintenant tant de choses que lui ne savait pas et ne pouvait pas savoir, ils n'aient pas su garder en leur esprit le sens des proportions et de la mesure, le sens des rapports entre les murs et les fenêtres, entre les pleins et les vides, des rapports entre la hauteur des maçonneries et celles des toitures, ce dont il leur avait laissé de si beaux exemples, et aussi le sens de l'emploi conjugué de matériaux différents concourant à l'unité,à la grandeur et à la beauté de son oeuvre ancienne.
Le vieil hôpital, malgré ses verrues modernes, ses adjonctions hétéroclites et ses laideurs surajoutées, reste encore pour nos constructeurs modernes une grande leçon et dont on ne voit pas que les architectes de l'Assistance publique se soient beaucoup inspirés dans leurs oeuvres récentes, même quand ils avaient tout à faire comme Claude Vellefaux, sur un terrain neuf et sans aucune gêne. Ici, je ne voudrais pas laisser place à l'équivoque, il ne s'agit nullement pour un moderne de prendre modèle sur un hôpital du XVIIe siècle pour construire un hôpital d'aujourd'hui. Mais quelles que soient sur le sujet les conceptions d'un architecte de nos jours, on pourrait souhaiter qu'il les réalisât en un monument ayant la même unité, homogénéité et simplicité, la même division visible des services, la même appropriation des bâtiments à leur rôle. On pourrait souhaiter que l'ensemble de son oeuvre donnât à l'oeil de tout homme sensible à l'architecture, la même joie., la même sensation d'harmonie dans ses proportions, et pour tout dire de beauté.
Je crois qu'il faut savoir gré, aux événements qui n'ont pas permis au baron de Breteuil de jeter bas l'hôpital Saint-Louis, même pour le remplacer par un autre. Nous sommes toujours beaucoup de simples citoyens qui aimons notre vieux pays, et dans ce vieux pays, le vieux Paris, fait d'une mosaïque de chefs-d'oeuvre, où chaque âge apporta son caillou. L'hôpital Saint-Louis représente un de ces cailloux, non des moindres, et même un des plus beaux.
Et n'est-il pas émouvant de voir une de nos sciences médicales, des plus utiles, elle-rnême de très ancienne origine, venue habiter ce vieux palais depuis si longtemps que lui et elle ne font plus qu'un et sont devenus synonymes. Le vieil hôpital fondé par Henri IV est devenu l'Ecole française de Dermatologie. Et je trouve même émouvant aussi de voir la quête ardue et ardente de la Vérité scientifique se poursuivre en un monument qui est une œuvre d'art splendide : Science et Beauté concourant au Bien que tout hôpital apporte à la Communauté humaine.
Dona Rodrigue